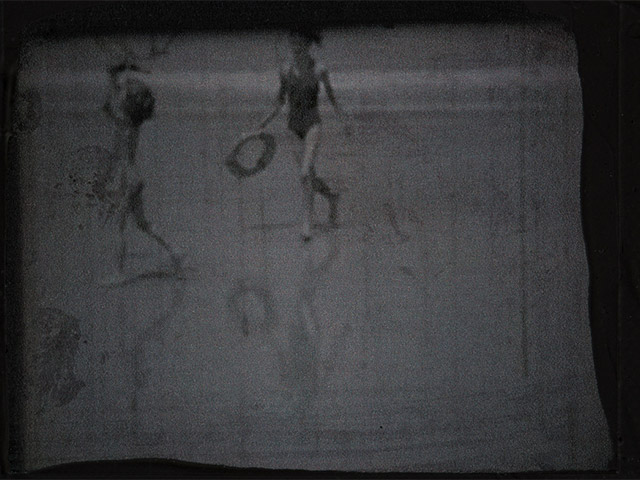
Entretien avec Arthur Dreyfus
Ecrivain franco-suisse (La Synthèse du camphre – Belle famille, Paris, Gallimard, coll. « Blanche »), journaliste (Positif – Technikart – France culture)
Comment avez-vous choisi le titre de votre exposition à artgenève ?
Il y avait des mots tirés d’un livre d’Andrei Tarkovski, qui depuis longtemps me fascinaient : Sculpting in time – sculpter le temps. Réfléchissant à mon rapport aux images animées, découpées, figées, cela s’est imposé comme une évidence. J’ai aussi pensé à un sous-titre en français, comme en écho : De peur que la nuit ne se referme.
Si « la nuit » ne s’est pas refermée, c’est grâce à votre père, qui vous a transmis sa collection de pellicules : archives familiales, anciens négatifs brocantés… Barthes nomme punctum le détail qui arrête son regard. Qu’est-ce qui vous point dans une courte séquence, et vous donne envie de la découper ?
D’abord, je connais bien ces films pour les avoir travaillés dans mon long-métrage les anonymes (2010). Ils m’ont habitée. Ensuite, comme dans tout choix, il y a une part de hasard. Toutefois, l’argument décisif reste l’émotion. La Chenille, par exemple, est un instant de bonheur absolu, qui dure très peu de temps. Sa joie contagieuse incite à l’isoler. Je pense à une autre séquence, qui ne figure pas dans la sélection : une femme invitée à une fête, portant un petit chapeau, et qui tout à coup sort de l’ombre. Le moment où son visage est touché par la lumière me procure une émotion immédiate.
Connaissez-vous les personnages de ces films ?
Certains. Un ami de mon grand-père par exemple, qui s’appelait Julien, fait le pitre dans l’une des séquences. C’est quelqu’un que j’appréciais, que j’ai connu âgé, mais qui avait conservé le même sourire.
Au fond, tous ces gens vivaient leurs vies sans penser qu’étaient gravées des « secondes magiques » de leur existence ; ni qu’une galerie les exposerait un siècle plus tard…
En ce qui me concerne, je n’ai conscience de vivre ces instants-là que lorsque je les photographie. Il me faut passer par l’objectif pour voir le réel autrement. C’est peut-être la raison pour laquelle je manipule si souvent des objectifs…
Que ressentez-vous à l’idée que tous vos personnages soient morts ?
C’est assez vertigineux, en effet : il y a l’idée de vanité, au sens artistique du terme. Ce rapport à la mort par l’image, je crois, est lié à mon histoire.
De quelle manière ?
Nous entrons dans la psychanalyse ! Mon père a perdu sa mère très jeune, à douze ans. C’est lui qui l’a trouvée morte dans l’appartement. Durant toute mon enfance, c’était un sujet assez tabou. Et à partir du moment où sa mère est morte, mon père a déserté l’école pour aller se réfugier dans les salles de cinéma. Sa passion pour les films, date de cette époque. Elle demeure associée à ce deuil. Au fil de mon enfance, j’ai compris que mon père se réfugiait aussi derrière sa propre caméra. Il filmait tout et tout le monde. Et un jour, alors que nous regardions certaines de ses images, il m’a dit : « Tu vois cette femme, ça pourrait être ta grand-mère. »
Les obsédés du film – ou de la photographie – semblent faire « des réserves de vie » pour plus tard…
Oui. Il y a clairement chez mon père une quête de vie à travers l’image – d’autant plus qu’il ne possède aucun film de sa mère. Filmer quelqu’un, c’est vouloir conserver son image vivante pour l’éternité. Mon premier film en Super 8 racontait l’histoire d’une femme morte revenue chercher quelqu’un sur terre…
Pourquoi n’êtes-vous pas devenue une pure cinéaste de fiction ? Comment est née votre pratique expérimentale ?
Il se trouve que je suis scénariste, par ailleurs, mais que je m’imagine jamais « réaliser » moi-même une écriture fictionnelle. Dès que je touche à une image, je m’approche de l’abstraction : j’ai été jusqu’à pratiquer le grattage sur pellicule.
Je reviens à Barthes et à sa définition de la photographie, comme certificat de réalité. La photographie montre quelque chose qui, incontestablement, a été. Face à vos images en noir et blanc, détériorées, avez-vous conscience que les personnages qu’elles représentent ont été vivants ?
Il faut distinguer la couleur et le noir et blanc ; qui déréalise davantage. Curieusement avec le noir et blanc, il y un doute, une distance. La réalité paraît plus proche dans les premiers films en Super 8 des années 60/70. Cette proximité les rend plus « véritables » à mes yeux.
Vous êtes-vous demandée ce qu’il y avait entre les 16 ou 24 images que capture une caméra chaque seconde ?
Sur la pellicule, c’est le noir qu’il y a entre les images. Dans mes œuvres, j’ai choisi de m’en tenir à ce noir, de le reproduire.
Et qu’est-ce que le noir ?
Pierre Soulages a prouvé qu’il était lumière… Mais pour moi, en l’occurrence, c’est la perte des images entre les images. C’est de la vie qui a existé, mais qui n’existera plus. Ne me sentant pas autorisée à la réinventer, le noir m’évite d’entrer dans la fiction.
Face à cinquante images presque identiques, observe-t-on chaque cliché séparément, ou bien l’œil reconstitue-t-il le mouvement général ?
Il y a une prise de conscience du mouvement général ; mais le spectateur va également chercher le mouvement dans chaque image fixe, quelle que soit sa place ou son format…
Que vous évoque le format 4/3 des photogrammes que vous découpez ?
Contrairement au 16/9, le 4/3 est une fenêtre. Il n’y a pas d’idée d’horizon. C’est donc plus intime, plus secret.
Vous souvenez-vous du tout premier moment où vous avez eu entre les mains une caméra, un appareil photographique ?
Je me souviens du jour où j’ai reçu ma première caméra. J’étais heureuse. La première chose que j’ai filmée, c’est ma maison, ses meubles, les gens autour de moi, et moi dans un miroir. Cela m’a frappée a posteriori : je filmais la réalité du quotidien, et non une occasion spéciale – un anniversaire ou un repas de Noël. Dès le départ, l’intimité me paraissait un sujet en soi.
Continuez-vous de filmer vos proches ?
Je préfère les photographier. Parce que j’ai peur que le film disparaisse, le jour où je ne serai plus là pour m’en occuper…
Il faut s’occuper des films ?
Oui, à cause de la volatilité des supports. Ce n’est pas pérenne, un film. Tandis qu’une photographie, une fois glissée dans l’album, semble là pour toujours. Elle ne requiert aucun medium.
Ainsi, en découpant des films, vous les transformez en photographies…
Voilà, je les sécurise : j’en prends soin.
C’est gentil de votre part ! Avez-vous le sentiment d’offrir un supplément d’éternité aux personnages que vous dévoilez ?
Oui, d’autant plus que ce sont des anonymes. C’est le paradoxe du cinéma, de créer des stars, qui paraissent éternelles quoique vouées comme les autres au néant. Avec « Trois secondes, deux images », j’offre à des gens qui n’y pensaient même pas un espace de représentation : je fais en sorte qu’ils ne soient pas oubliés, en leur rendant une part de lumière.
N’y a-t-il pas un aspect fantomatique dans cette série ?
Je ne dis pas le contraire. L’acte de mémoire comporte une part macabre – mais dans cette série, je retiens en priorité la lumière de vie que dégagent des moments heureux, des fêtes, des sourires… Si fantômes il y a, ce sont, je l’espère, de gentils fantômes.
Sur un plan personnel, comment faites-vous pour profiter des moments heureux, et savourer au présent cette « lumière de vie » ?
C’est un apprentissage quotidien – mais la naissance de mon enfant m’a fait prendre conscience, comme jamais auparavant, que tous les minuscules moments vécus avec lui étaient précieux, parce que uniques. J’ai longtemps préféré la nuit : depuis peu, j’apprends à aimer le jour.
La photographie est l’art de la lumière – donc du jour…
Bien sûr ; et l’éveil d’un enfant, l’évolution de son regard, ses premiers mots, comme la photographie, ont le pouvoir d’arrêter le temps.
Je pense à une autre de vos œuvres : « Et la lumière fut », à ce carré d’or enfermé dans un espace noir… Ici aussi, un miracle de lumière, perdu dans la masse de l’éternité, semble arrêter le temps.
Pour moi cette œuvre est une bataille : je souhaitais qu’on ne sache pas si la matière noire allait recouvrir l’or, ou si l’or allait se déployer pour absorber le noir. C’est d’ailleurs ainsi que je conçois la vie. Un éclat de lumière dans le chaos. L’infime conscience humaine isolée dans l’univers sans bornes…
À l’échelle de l’univers, je pense que le carré d’or serait plus réduit !
Certes, mais à mes yeux le noir va bien plus loin que la toile. Au-delà du cadre, qui n’est qu’une limite artificielle, le noir s’étend à l’infini. D’où l’importance de traquer les zones d’or, où qu’elles soient, et de les célébrer, dès qu’on peut.

